Pourquoi on a besoin de Jung aujourd’hui
Je vous offre un cours vidéo gratuit
> Cliquez ici
Au XXIème siècle, on a besoin de Tonton Jung ! Je vous ai expliqué dans un précédent article pourquoi Carl Gustav Jung a longtemps été boudé par les enseignements universitaires, et pourquoi il devient malgré tout de plus en plus populaire.
Dans cet article je vous expliquerai pourquoi on a besoin de Jung aujourd’hui. Nous verrons comment la psychologie de Jung peut être un rempart à la folie de notre époque, et comment il peut nous inspirer pour ne pas se perdre soi-même en perdant de vue l’essentiel.
I] La psychologie de Jung : un rempart à la folie de notre époque
A) Une psychologie de l’équilibre
Science avec conscience et sans ruine de l’âme
Carl Gustav Jung était à la fois très rationnel, très carré – il était psychiatre et avait donc une formation scientifique. Mais il avait aussi un côté artiste, poète “inspiré” et la spiritualité avait une place importante dans sa vie. Il se passionnait aussi bien pour la science que pour l’histoire, la philosophie, la mythologie et les religions.
C’est cet équilibre, entre rationalité et spiritualité que l’on rencontre chez Jung et dont on a besoin aujourd’hui. A notre époque, on voit bien les limites de la science et les dégâts que cause à la nature l’ère du “tout scientifique”. Le progrès, poussé à l’extrême et entendu en tant qu’amélioration de l’homme et contrôle de la nature, détruit notre environnement et a un impact sur la santé physique et mentale.
Aujourd’hui on doit réfléchir à une autre acception du “progrès”. Le progrès ne doit pas qu’être progression linéaire et ascensionnelle, il ne doit pas perdre de vue le bon sens fondamental, les valeurs, et l’équilibre des forces de la nature. Ce sont des enseignements que l’on est forcé de tirer de l’état actuel du monde, que ce soit sur le plan géopolitique, économique ou écologique. Mais aussi psychologique.
Or cette notion d’équilibre est centrale dans la pensée jungienne. L’excès n’est jamais vu d’un bon œil, ni l’excès de bien ni l’excès de mal. Ce qui permet d’éviter les excès et donc les déséquilibres, c’est la conscience. La conscience voit ce qui est et ne cherche pas à dominer, à changer l’ordre des choses. La conscience entend accompagner le mouvement d’évolution de l’être humain et du monde qu’il habite, afin que cette évolution soit harmonieuse, et non pas mue par une volonté de puissance disproportionnée qui mène automatiquement à la chute.
C’est pourquoi j’ai fait un clin d’œil à Rabelais dans mon titre, qui écrivait il y a 500 ans “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”. Or l’âme est au centre de la pensée jungienne.

Sur un plan psychologique, comment se manifestent ces excès ?
L’excès de “mieux”, l’excès de “progrès” est visible dans toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui entendent vous motiver à devenir meilleur, comme si la personne que vous êtes n’était pas déjà suffisamment bien.
Par exemple le fameux “devenir la meilleure version de soi-même”. C’est une injonction absolument terrible ! Elle sous-entend que vous devriez atteindre une manière d’être meilleure, donc que tel que vous êtes actuellement vous n’êtes pas assez bien, pas assez performant, pas assez musclé, pas assez solide… Pas assez ceci ou cela pour vous aimer tel que vous êtes, pour vous valider, pour être bienveillant envers vous-même et pour vous récompenser. En bref, pour avoir le droit d’être heureux tout de suite.
Et alors, la question est : à quel moment est-ce que vous aurez atteint cette meilleure version de vous-même? A quel moment vous saurez que vous êtes allés assez loin dans le dépassement de vous-même pour avoir droit au bonheur ?
C’est une histoire sans fin! Ce n’est plus une quête saine, c’est une course à la performance.
Or nous savons que le bonheur n’est pas une cible, c’est une force tranquille. Ce sont les plaisirs que l’on peut “viser” à la limite, les plaisirs sont nécessaires mais ils sont fugaces. Le bonheur, lui, est une aptitude intérieure à développer et une attitude face aux événements. On peut être heureux tout en traversant des moments de grande tristesse et de turbulences. La vie est ainsi. Le vrai bonheur c’est aussi d’accepter les émotions négatives. L’idée “d’atteindre le bonheur” est donc dangereuse. “Atteindre…” Mais atteindre quoi ? Il n’y a rien à atteindre, il y a à être, car le bonheur vient de Soi et non pas des conditions extérieures.
B) Une psychologie du présent
Ne pas perdre de vue son centre
Notre société a besoin que nous soyons dans cette course à la performance. L’économie fonctionne parce que nous voulons gagner plus, obtenir plus, améliorer nos conditions de vie, même quand celles-ci sont déjà satisfaisantes. D’où la difficulté collective à être dans le présent. Le présent n’est jamais suffisant, il y aura toujours mieux après.
Ces vidéos de motivation qui pullulent sur les réseaux sociaux ne sont pas tournées avec de mauvaises intentions. L’idée est belle : aider les gens à trouver en eux la force de réussir à accomplir ce qu’ils ont à accomplir, et de s’en sentir capable. Mais le problème c’est que la direction donnée est fausse.
L’évolution ne suit pas une courbe strictement ascensionnelle, et celle de l’être non plus. Il y a des moments de progression rapide, et des moments de régression. Deux pas en avant, un pas en arrière. Et faire ce pas en arrière régulièrement est gage de conscience justement. C’est parce que je peux prendre du recul, être dans un temps de pause, de stagnation, que je peux assimiler les leçons que m’a données la vie, revenir à moi me recentrer, et ainsi ne pas perdre de vue qui je suis.
Ne pas perdre de vue mon “centre” c’est un besoin fondamental d’équilibrage, c’est ce que Jung appelle le moment d’extraversion et d’introversion : être parfois proactif, et parfois se poser et rentrer en soi.
L’évolution comme une éclosion
En psychologie jungienne, la notion de centre est fondamentale. Il s’agit d’évoluer, certes, dans le sens de “grandir”, “mûrir”, être de plus en plus capable de naviguer dans l’existence, mais en accord avec ce centre de la personnalité. Il ne s’agit donc pas de suivre une ligne de croissance sur un graphique, c’est plutôt l’image d’une expansion venue d’un centre, donc plutôt l’image d’une fleur qui éclot.
Ce centre c’est ce qu’on appelle le Soi en psychologie analytique. Le Soi est ce noyau qui fait notre nature profonde, individuelle, qui fait notre magie et le point de départ de tous nos potentiels. Et c’est en y revenant régulièrement qu’on va éviter de se perdre en courant après des chimères, en gaspillant notre énergie au bénéfice d’objectifs qui, une fois atteints, ne nous nourrissent pas.
En effet, pourquoi est-ce que je ne me sens pas plus heureux une fois que j’ai atteint la cible ? Parce que finalement, ma nature profonde ne s’y retrouve pas.
Ainsi, garder de vue son centre permet de toujours revenir au présent. De ne pas trop s’éloigner de ce qu’on est fondamentalement, de ne pas tomber dans une performance conforme aux modèles dont les réseaux sociaux nous abreuvent, et qui sont des modèles collectifs, assez inhumains finalement.
Sous des revendications saines en apparence “être la meilleure version de soi-même” et “atteindre le bonheur” sont les meilleurs moyens de se créer de belles névroses.

II ] Une psychologie de “l’Âme”
A) Carl Gustav Jung interpelle l’âme
L’âme : ce qui m’anime
Jung parle de l’âme. En réalité Freud aussi, si on s’en tient à ses textes originaux, en langue allemande, mais c’est un autre débat…
Dans la notion d’âme, Jung désigne ce qui anime l’individu, il revient donc à la conception latine “anima/animus”. Il n’inscrit donc pas l’âme dans une dimension religieuse mais ne l’exclut pas non plus.
L’être humain est un être religieux
Pour Jung, l’être est un être religieux, mais pas au sens de “religion”. Un être religieux pour Jung désigne un être qui se pose des questions sur la vie après la mort, sur le sens de sa vie, sur le sens du monde, sur lui-même, sur ses relations, sur l’amour, sur la justice…etc. Pour Jung, c’est cela être un être religieux, c’est à dire un être qui a besoin de se relier (pour en revenir également à l’étymologie du mot). Qui va chercher à voir les choses avec du recul, à évoluer, à gagner en maturité autrement dit en conscience, et à accomplir sa vie du mieux qu’il peut. Les animaux n’ont pas ce genre de besoin, et c’est cela qu’il faut comprendre lorsque Jung parle de “sentiment religieux”, de « besoin religieux ».
Ceci dit, dans une fin de XXème siècle qui se méfiait beaucoup de ce terme “religieux”, il est compréhensible que Jung ait pu s’attirer un sentiment de méfiance.
Aujourd’hui c’est différent, les gens cherchent activement à se connaître eux-mêmes, à résoudre leurs conflits, à comprendre leurs émotions. La psychologie fait maintenant partie de la vie quotidienne, et le courant du développement personnel a renforcé cette conception là : je ne me connais pas complètement et me connaître mieux est la clé pour m’accomplir.
B) Psychologie, développement personnel et spiritualité
Jung intéresse… tout le monde !
Ce qui est assez génial, quand on observe les différents types de personnes qui s’intéressent de nos jours à Jung, c’est que ce ne sont pas seulement des lecteurs de manuels de psychologie.
Parmi les lecteurs de Jung, il y a des psychologues certes, mais aussi des thérapeutes divers et variés, des philosophes, des artistes, des passionnés de développement personnel et des personnes qui se posent des questions plutôt du domaine de la spiritualité.
Donc finalement, toute personne qui s’engage, seul ou accompagné d’un thérapeute, dans un travail sur soi-même, va probablement avoir besoin de Jung sur son chemin aujourd’hui.
Car Jung a justement cette ouverture qui lui causait du souci à son époque, et qui est appréciée aujourd’hui.
En effet, au XXème siècle, le paradigme freudien correspondait mieux au besoin de réponses de l’époque que l’univers de Jung. Aujourd’hui, c’est moins de réponses dont on a besoin, que de propositions. Lorsqu’on lit un livre de Jung, on ne le lit pas “vite”. On lit, puis on lève le nez, on médite sur ce passage. On reprend la lecture. On pose le livre, parfois pendant plusieurs jours, on y revient… Jung nous propose d’élargir notre regard sur nous-même et pour cela il n’hésite pas à parler de son propre cas, de ses propres difficultés et du constat de son ignorance.
Ainsi il se montre extrêmement humain dans ses écrits, et non pas professoral. Il s’est d’ailleurs toujours présenté comme un chercheur et non pas comme un “trouveur”. (J’assume ce mot peu usité et qui va en crisper quelques-uns mais comme vous le savez en fin d’article, je m’autorise quelques libertés).
Qui plus est, Jung a l’habitude de chercher à relier ses observations cliniques et ses expériences personnelles à une expérience humaine qui peut concerner chacun des êtres humains. C’est pour cela qu’il aime plonger dans les mythes, dans les religions, dans la littérature alchimique, c’est pour cela qu’il a entrepris de grands voyages aussi, dans une démarche proche de celle d’un ethnologue.
Pour Jung, l’être humain traverse des étapes et des crises existentielles que tous les êtres humains vont être amenés d’une certaine manière à traverser aussi. Et ces turbulences sont de grands moments pour l’âme, décrits merveilleusement par les légendes aux quatre coins du monde, et qui donc ne sauraient concerner uniquement le domaine de la psychologie.

Jung est un bon parrain pour toute démarche d’introspection
Cette démarche d’introspection, qu’elle soit donc abordée par le biais de la psychologie ou plutôt du développement personnel est une démarche proprement spirituelle. L’idée étant de ressentir la guidance de son être, de sa nature profonde et d’agir en accord avec qui je suis, dans le respect de mon histoire, des mes valeurs, de ma personnalité et bien entendu dans les limites de mon humanité. (Ne jamais chercher à devenir un surhomme, au risque de perdre son âme, comme nous l’avons vu au début de cet article).
Or ma nature, mon être profond, c’est ce qu’on désigne par le mot “âme”. La notion d’âme de nos jours s’offre une nouvelle jeunesse, libérée du carcan d’un cadre strictement religieux. (Ce qui me réjouit personnellement car c’est un mot que je trouve magnifique!)
Le “tout-scientifique” a montré ses limites. Aujourd’hui les gens ont compris que, pour se sentir vivre, il faut se relier à son âme. Nous ne sommes pas qu’un cerveau, nous sommes un corps, avec des sensations, un cœur avec des émotions, et une âme qui traverse des épreuves et qui est, comme le disait les grecs: “pneuma”, souffle de vie. Une âme qui anime le corps d’un être humain, une âme qui est à voir comme un centre avec lequel on doit veiller à rester toujours relié.
Merci de m’avoir lue !
Faites de beaux rêves et notez les !
Léa Le Gall
Si cet article vous a plu, je vous invite à regarder mes vidéos sur Youtube à propos du rêve et de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung
Voir la chaîne YT de Léa Le Gall
Publié le
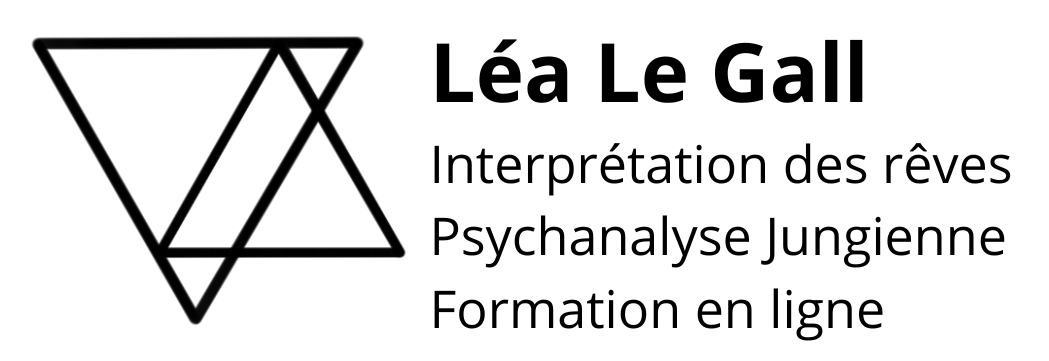
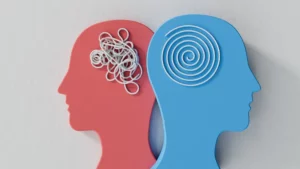

7 Commentaires:
Haha, cette course effrénée vers la meilleure version de soi-même ressemble à essayer de courir vers larrivée dune course qui na même pas de départ défini ! On gaspille des calories visant des cibles qui nexistent que sur les réseaux sociaux, comme si on tentait de voler un papillon pour lemmener dans un musée. Larticle a raison, le bonheur nest pas une cible à atteindre, cest plutôt la capacité de savourer la confusion quotidienne en restant ancré dans son centre, même si ce centre est juste un canard perché sur un pond. Lâcher prise, cest la vraie performance !
Ah, cette quête infernale de la meilleure version de soi-même ! On court après une cible qui nexiste pas, gaspillant notre énergie pour atteindre des paliers de performance qui nous laissent ultimately déçus. Cest comme si on essayait de voler un oiseau pour le mettre dans une cage où il pensera être heureux. Le vrai bonheur, cest deFinally réaliser que le présent, avec ses plis et ses plis, est déjà la fleur qui éclot depuis notre centre profond. Lâcher prise sur cette course effrénée vers labsolu, cest déjà gagner. Car, comme le dit bien larticle, le bonheur nest pas un objectif, cest une attitude, une aptitude intérieure que lon cultive, pas à la force, mais à la sérénité. On est assez content de ce que lon est, merci de tout ce que vous avez fait !Đồng hồ bấm giờ online
Merci beaucoup pour votre commentaire qui me motive dans ce sens ! Ouf, le monde n’est pas encore totalement tombé sur la tête, la sagesse reste à portée de main 🙂
Cest drôle, on cherche la meilleure version de soi-même comme son était une version de Windows à mise à jour ! Cette course effrénée vers le centre mévoque plutôt une grenouille qui tente de sortir dun bol de crème, en se retrouvant toujours un peu dans le brouillard. Jung, avec son Soi, ressemble à un guide dans un parc dattractions intérieur, disant : Regardez autour de vous, cest tout ce quil y a !. Pourquoi pas opter pour la névrose saine de se rire de soi, plutôt que de courir après des cibles qui napportent que des plaisirs fugaces ? La vraie clé, cest peut-être daccepter notre version 1.0, avec toutes ses bugs, et de laimer, enfin !grow a garden calculator
Oui je suis d’accord, rire de soi, c’est accéder au « rire des immortels » comme dans le livre Le Loup de Steppes d’Herman Hesse 😉
Cest drôle, cette course effrénée vers la meilleure version de soi-même ! On court après le bonheur comme sil était une cible à atteindre, en oubliant que cest peut-être plus une force tranquille venue dênous. Ces videos de motivation, elles, cest un délice ! Un cocktail parfait dinjonctions à lamour de soi et de la tristesse collective. Enfin, on apprend à ne pas se perdre en courant après des chimères, mais plutôt à éclore doucement, comme une fleur, avec son Soi au centre. Bien sûr, qui ne veut pas être une légende à soi-même, mais sans les chimères, où est le fun ? Cest comme demander à une fleur déclater sans soleil, ou plutôt sans Soi !đếm ngược thời gian
Merci pour votre commentaire, je suis bien d’accord avec vous ! Je pense que nous n’avons pas le même genre de vidéos de motivation dans notre feed instagram haha ^^ C’est chouette de motiver les gens bien sûr, à condition de ne pas les déprimer en les motivant à devenir… Ce qu’ils ne sont pas ! Et oui le fun, très important 😉