Les complexes autonomes – Carl Gustav Jung
Je vous offre un cours vidéo gratuit
> Cliquez ici
Le concept des complexes autonomes est un terme de Carl Gustav Jung utilisé en psychologie analytique, en psychanalyse et en thérapie.
La psychologie analytique est une branche de la psychanalyse développée par Carl Gustav Jung. Partageant des idées de base avec la psychanalyse c’est-à-dire la méthode thérapeutique initiée par Sigmund Freud, elle s’en démarque en y ajoutant des notions qui viennent compléter les découvertes de Freud. C’est pourquoi si vous avez fait une analyse freudienne, il est probable que vous n’ayez jamais entendu parler de cette notion.
En analyse jungienne, il s’agit d’une notion centrale comme nous allons le voir dans cet article.
Dans un premier temps nous allons proposer une définition du complexe autonome, en le différenciant de ce qu’on entend d’habitude par complexe : “j’ai des complexes”, par exemple je suis complexée par mon corps… Ou encore le fameux “complexe d’Oedipe”…
Un complexe autonome, ce n’est ni l’un ni l’autre. Une fois que nous aurons défini ce dont il s’agit, nous allons réfléchir à la façon dont il peut se former.
Ensuite, je vous parlerai de mes complexes autonomes et de la difficulté de dealer avec. J’espère que ça vous amusera de découvrir les différentes facettes de ma personnalité qui doivent, tant bien que mal, s’entendre. Parfois elles y arrivent, parfois c’est plus compliqué. Mais les avoir identifier, et pouvoir les reconnaître, est une réelle aide pour pouvoir respecter notre nature profonde, dans toute sa diversité, et donc être plus à l’écoute de ses besoins.
Enfin, je vous parlerai de la façon dont je travaille en psychanalyse pour accueillir ces complexes autonomes, que ce soit dans l’échange ou en analyse de rêve. Et je vous proposerai un petit exercice que j’ai imaginé dans ma pratique de psychanalyste et qui peut vous aider à faire une place à tout ce que vous êtes, même à vos parts d’Ombre, et même aux aspects inconnus de votre personnalité.

I] Les complexes autonomes : définition
A) Ce qu’un complexe autonome n’est pas
Ce n’est pas “je suis complexé(e)”
Dans le langage courant, lorsqu’on dit “j’ai un complexe”, ça signifie: je suis complexé(e), autrement dit par quelque chose qui abîme ma confiance en moi. L’adolescence est l’âge d’Or du complexe dans ce sens-là : on est complexé par la taille de ses seins, par son poids, par sa timidité… Par à peu près tout ce qui est possible et imaginable!
Mais un complexe autonome ne désigne pas ce genre-là de complexes.
Ce n’est pas “le complexe d’Oedipe”
Même ceux qui ne s’intéressent pas spécialement à la psychanalyse ont entendu parler du complexe d’Oedipe, et de son équivalent le complexe d’Electre. Pour faire simple parce que ce n’est pas le sujet ici, ils désignent un problème cristallisé dans la relation parent-enfant, qui s’étend dans les rapports de l’individu adulte au monde.
L’idée de “complexe d’Oedipe” est passé dans le langage courant et tout le monde voit à peu près de quoi il s’agit.
Depuis Freud, de nombreux psychanalystes ont mis à jour des complexes dans ce genre, c’est-à-dire des modes de fonctionnement problématiques qui prennent racine dans l’éducation. Souvent ces psychanalystes se basent sur un mythe ou sur un conte, pour illustrer un mode de fonctionnement qu’ils ont pu observer suffisamment souvent dans leur travail clinique pour finir par avoir besoin de le décrire et de le nommer.
La critique principale à ces “complexes” théorisés par les psychanalystes du XXème siècle est la généralisation des observations émises par un seul observateur, ce qui questionne évidemment quant à l’objectivité et les projections. Aujourd’hui on parle plutôt de “syndrôme” et la critique reste la même : par exemple, sont visés par ces critiques les populaires complexe de Cendrillon de Colette Dowling, et syndrome de Peter Pan de Dan Kiley.
Vous l’aurez compris, ce n’est donc pas non plus en ce sens là, au sens de “complexe d’Oedipe” ou de “complexe de Cendrillon” qu’on appelle les complexes autonomes en psychologie analytique.
Bon, mais alors de quoi ils parlent, ces jungiens, quand ils parlent de complexes autonomes à la fin? On y vient.
B) Le complexe autonome en psychologie analytique
Et Carl Gustav Jung découvre les complexes autonomes
Carl Gustav Jung va un temps embrasser la définition freudienne du “complexe”, puis s’en démarquer. Dans son travail clinique tout d’abord, en tant que psychiatre, il observe que dans des cas de grande souffrance (névrotique ou psychotique) l’individu semble en conflit avec lui-même, mais pas avec un seul lui-même, avec plusieurs facettes de sa personnalité.
Il conçoit un psychisme pluriel, où finalement ce qui constitue l’inconscient est peuplé de diverses tendances qui peuvent s’observer dans les variations d’humeur, dans les envies, dans le choix des activités et dans la façon de se conduire de l’individu.
L’hypothèse qui se dessine pourrait se résumer ainsi : et si finalement, en plus de la personnalité principale, communément appelée “le Moi”, il existait dans la psyché des sous-personnalités annexes? Annexes mais qui joueraient un rôle important dans la psychologie de l’individu, et qui seraient impossibles à canaliser complètement.

Définition du complexe autonome par Carl Gustav Jung
Dans L’homme à la découverte de son âme en 1934, Jung écrit :
« Les complexes jouissent d’une autonomie marquée, c’est-à-dire qu’ils sont des entités psychiques qui vont et qui viennent selon leur bon plaisir ; leur apparition et leur disparition échappent à notre volonté. Ils sont semblables à des êtres indépendants qui mèneraient à l’intérieur de notre psyché une sorte de vie parasitaire. »
Ainsi le mot “complexe” ici renvoie à un nœud, à l’idée d’un noyau, et “autonome” parce que ces sous-personnalités semblent se manifester sans que le Moi soit en capacité de les contrôler, ou bien de façon très limitée.
C’est comme si ces sous-personnalités surgissaient de l’inconscient selon les situations rencontrées, pour exprimer un besoin de l’âme et tenter un rééquilibrage.
Par exemple, pour Jung, dans les années 1910, une envie d’écrire (ce qui deviendra le Livre Rouge), de construire, de peindre, un besoin de solitude… Il va découvrir une facette de sa personnalité artistique et solitaire, qui s’imposera comme pour prendre le contre-point de sa personnalité principale de médecin, extraverti et séducteur.
Il acceptera pour le reste de sa vie de jongler avec les deux, ayant ainsi compris que sa facette introvertie, mise au ban de sa persona et donc devenue complexe autonome, était nécessaire pour compenser l’activité sociale et les ambitions de sa blouse de médecin, et lui permettre de se relier à son âme.
Carl Gustav Jung face à ses propres complexes autonomes
Ainsi Jung a l’aube de la quarantaine fait l’expérience de ce qui corrobore ses observations cliniques et qui pourrait s’exprimer ainsi : il semblerait en effet, que je ne sois pas un bloc monolithique mais que je suis une personnalité plurielle, plus riche que je ne l’imagine, et plus complexe – c’est le cas de le dire – que ce que mon Moi veut bien raconter de moi.
Il existe d’autres facettes de ma personnalité que je ne connais pas assez et qui jouent pourtant un rôle nécessaire dans mon système. Et si on partait à leur rencontre?
C) Concrètement, comment reconnaitre un complexe autonome ?
Nous sommes tous sous l’influence de nos complexes autonomes. Certains apparaissent de manière plus régulière que d’autres. Un complexe autonome apparait soit car une situation l’active, soit pour compenser une dynamique qui aurait tendance à devenir unilatérale.
Apparition réactionnelle
Dans le cas d’un complexe autonome qui ressortirait en réaction à une situation, prenons l’exemple de l’impulsivité. Quelqu’un de doux et de sensible peut également faire preuve d’une grande impulsivité et dire après coup “c’était plus fort que moi”. Ou bien “je n’ai pas pu m’en empêcher”.
C’est exactement ce type de remarque qui indique qu’il y a là un complexe autonome qui s’est exprimé. Face à une attaque par exemple, la personne douce peut avoir une sous-personnalité violente qui va se montrer, et qui semble être en décalage avec son tempérament. En réalité, elle est juste inconnue ou méconnue, reléguée dans l’Ombre, en “marge du système”.
Apparition compensatoire
Dans le cas d’un complexe autonome qui apparaîtrait pour compenser une attitude trop unilatérale, prenons l’exemple de quelqu’un qui se soumet à une discipline impitoyable. Il se lève très tôt, il s’astreint à une routine exigeante… etc. Si bien qu’il n’y a pas vraiment de place pour le plaisir, tellement tout est “dur” dans sa façon d’aborder chaque tâche.
Ainsi, les rares fois où il aura “quartier libre”, où il ne sera pas en train de plier sous le poids de cette discipline, il va aller faire la fête et n’aura pas de limite. Pourquoi ? Parce que son besoin de se soumettre à ce quotidien hyper contrôlé aura nourri le complexe autonome situé à l’opposé du contrôle : donc une sous personnalité sans limite et malgré tout excessive, non plus du côté de l’ascétisme mais excessive dans la fête et l’alcool.
Voilà, normalement vous pouvez tous vous identifiez de près ou de loin à ces deux exemples, et ressentir de quoi il s’agit !
II] Comment se construit un complexe autonome ?
Alors ces sous-personnalités, comment s’expriment-elles concrètement ? A quoi ressemblent-elles ? Comment sont-elles nées et comment se sont-elles construites ?
Nous allons voir que les complexes autonomes peuvent se cristalliser dans l’enfance bien sûr, au moment où on forge notre personnalité afin d’être dans les clous de ce que notre environnement attend de nous. Ainsi que tout au long de la vie d’adulte, dans nos efforts d’adaptation constants.
Nous verrons aussi que bien souvent c’est nous-même qui avons banni certaines facettes de notre personnalité qui ne correspondent pas à la personne que l’on croit vouloir devenir.

A) Complexes autonomes apparus dans l’enfance
Mon lien à l’autre et ma présence au monde
L’enfance joue un rôle déterminant dans le choix des tendances naturelles de l’individu qui vont ou non être intégrées au Moi. Sous l’influence de l’éducation, de la famille, de la société, une première sélection se fait parmi mes capacités, entre celles que je suis encouragée à développer, et celles que je ne suis pas autorisé(e) à exprimer.
Ainsi, plus je vais grandir, plus je vais favoriser certains traits de ma personnalité au détriment d’autres. Certaines de mes tendances naturelles vont se mettre sur le devant de la scène pour dessiner les contours de mon Moi. Celles qui sont adoubées par l’entourage et bientôt par le Surmoi. Cependant, les autres tendances ne disparaissent pas. Elles restent en veille dans l’Ombre, derrière, sous-développées certes mais elles ne sont pas mortes. Elles deviennent nos premières personnalités “exclues” du système, et donc nos premiers complexes autonomes.
Les complexes autonomes formés au cours de l’enfance ont souvent une tonalité affective. Ils concernent le relationnel.
L’exemple des émotions
Par exemple, si on ne m’a pas accompagné(e) dans la gestion de mes émotions – je prends cet exemple exprès car on est probablement 90% à être concernés ! – alors on peut avoir les complexes autonomes suivants :
- Si j’ai dû cacher mes émotions – je risque d’avoir un complexe autonome défensif dès que je n’arriverai pas à les dissimuler, avec une réaction d’attaque ou de fuite.
- Si on ne m’a pas donné de cadre pour réguler mes émotions – alors je peux avoir un complexe autonome capricieux voire violent.
- Si on ne m’a pas appris à prendre la responsabilité de mes émotions – alors je peux avoir un complexe autonome victimaire, avec une tendance à rejeter sur les autres la responsabilité de ce que je ressens…
Etc, je donnerai d’autres exemples plus loin. Comme vous l’aurez compris, les complexes autonomes forgés dans l’enfance touchent à l’émotionnel, au lien à l’autre et à notre présence au monde.
Les grandes blessures de l’âme définies par Lise Bourbeau (abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice) vont provoquer la création de complexes autonomes. Ainsi, lorsqu’on va à la rencontre d’un complexe autonome, on va aussi avancer dans la compréhension de nos blessures et dans leur réparation.
B) Au grès des expériences
Tout au long de l’existence, nos expériences de vie nous invitent à adapter ce que nous montrons de nous-même, et parfois la conjoncture va nous amener à discriminer certaines facettes de notre personnalité par conformisme, par imitation ou par nécessité. Et puis il y a le cas des traumatismes.
Conformisme par nécessité
J’entends par là si j’évolue dans un environnement oppressif. Par exemple si je suis homosexuel à une époque et dans un pays où c’est considéré comme un tort, je peux refouler ma sexualité véritable, et apparaîtra alors un complexe autonome, qui d’ailleurs peut sembler n’avoir rien à voir avec le sacrifice initial.
Conformisme par imitation
Par exemple si j’ai un métier qui me permet d’avoir un équilibre familial et des loisirs. Si j’ai une augmentation “qu’on ne refuse pas” dans une multinationale qui me demande de passer la moitié de ma semaine dans des vols internationaux, je vais gagner mieux ma vie mais sacrifier les loisirs et la famille. Il va donc y avoir un manque qui peut se cristalliser sous forme de complexe autonome. Pourtant j’ai le choix, je me prive tout seul finalement.
C’est ainsi qu’on peut renoncer à certaines facettes de notre personnalité que l’on jugerait non conforme à ce que la vie attend de nous, ou du moins ce que l’on croit que la vie attend de nous. Car bien souvent c’est surtout nous-même qui nous frustrons tout seul, qui nous amputons d’un pan de nous-même, sans que personne ne nous y oblige, par Ego. Pour ressembler à l’image que nous nous faisons de la personne que l’on veut être, on pose soi-même les barreaux de sa prison…

Le cas des expériences traumatiques
Les traumatismes créent des dégâts considérables dans la santé mentale d’un individu. Parmi les conséquences d’un traumatisme, il y a le clivage, et la dissociation. Etats passagers puisqu’il s’agit de systèmes de défense qui assurent la survie de l’individu, notamment en lui évitant de succomber à une surcharge d’adrénaline et de cortisol – les hormones du stress à haute dose étant toxiques.
Il va sans dire que suite à un traumatisme, il peut y avoir un complexe autonome qui va se cristalliser quelque part. Un travail thérapeutique est indispensable.
Le cas du Trouble Dissociatif de l’Identité
Dans le cas de traumatismes répétés, de violences physiques voire sexuelles fréquentes dans l’enfance, la personnalité principale – le Moi – peut imploser complètement et se diviser en plusieurs personnalités toutes ex-aequo : c’est ce qu’on appelle le TDI (le Trouble Dissociatif de l’Identité).
Les personnes atteintes de ce trouble vont avoir un certain nombre de personnalités différentes qui vont se succéder au gré des événements de leur journée. Par exemple dans une situation de stress il y aura une personnalité qui gère mieux le stress, dans une situation de joie, il y aura une personnalité qui répondra à cette joie…etc. Ces personnalités ont souvent un prénom chacune, et parfois des sexes différents.
La prise en charge ici doit être pluridisciplinaire et le suivi régulier. La théorie des complexes autonomes de Carl Gustav Jung a participé à la reconnaissance de ce trouble en psychologie.
C) Pour compenser le Moi
Enfin, certains de nos traits de caractère ont été bannis de notre personnalité par nous-même et sans pression extérieure ni pression interne. En effet, nous sommes très doués pour nous créer des problèmes tout seul… Certains complexes autonomes proviennent donc juste du fait qu’à un moment donné j’ai décidé d’être ceci ou cela (au détriment du reste).
Moi Je Suis ceci ou cela
Blague à part, c’est un phénomène incontournable et tout à fait logique. Si je veux que les autres me voient d’une certaine façon, je vais donc naturellement avoir tendance à bannir la façon d’être opposée. Or les opposés sont en réalité les deux faces d’une même pièce.
Ces traits de caractère bannis du Moi vont devenir des complexes autonomes, c’est -à -dire comme vous l’aurez compris, qu’elles vont se construire en parallèle du Moi comme des sous-personnalités à part entière. Ainsi, en marge de la version de moi-même que je m’autorise à être, il y a d’autres versions de moi-même que je considère comme moins légitimes et que j’ai repoussé plus loin.
Elles n’ont pas disparu pour autant, elles tournent autour de moi telles des satellites et continue à m’influencer, de même que la lune a une influence sur la terre.
Les complexes autonomes qui compensent le Moi sont plus difficiles à admettre car ça touche à la volonté de puissance et donc ils sont chargés d’angoisse, et perçus comme des fauteurs de trouble.
Des complexes autonomes qui mettent la pagaille
Le Moi choisit la facilité et il peut aller trop loin dans une attitude qu’il maîtrise, qui le séduit et le sécurise, mais qui en devient unilatérale. Dans ce cas, l’Ego a pris trop de pouvoir et n’est plus à sa place.
Alors l’inconscient va chercher à compenser. Or compenser, ça veut dire nuancer, et la nuance exige une bonne dose de déconstruction… Et c’est ainsi qu’un complexe autonome compensatoire, qui serait là pour faire redescendre l’Ego de son piédestal, peut être perçu comme un perturbateur, créant des contrariétés et du désordre dans la vie de l’individu. C’est ainsi qu’il va le vivre, mais en réalité c’est une tentative de régulation du système, qui aboutit à une remise en question.
Car comme l’écrit Carl Gustav Jung dans L’Homme à la découvert de son âme en 1934 :
“ Au prix d’un effort de volonté, on peut à l’ordinaire réprimer un complexe, le tenir en échec ; mais aucun effort de volonté ne parvient à l’annihiler, et il réapparait, à la première occasion favorable, avec sa force originelle. »
En psychanalyse jungienne, on va à la rencontre des complexes qui s’invitent en séance, et que dans la quotidien on aurait tendance à dénigrer. L’analyse est un espace de rencontre avec Soi, et se rencontrer soi-même c’est rencontrer nos paradoxes, nos zones d’Ombre, et l’inconnu en nous.

IV] Les complexes autonomes : un terme jungien pour un concept vieux comme le monde
Le concept des “complexes autonomes”, ainsi nommé par Carl Gustav Jung, est très utile en analyse jungienne et a été également repris dans bon nombre de thérapies qui ont vu le jour depuis.
Le postulat pourrait se résumer ainsi : et si, contrairement à ce qu’on croit, nous n’aurions pas une seule personnalité mais nous serions finalement pilotés par plusieurs personnalités qui cohabitent en nous ?
Ça vous parait farfelu ? Pourtant, cette thèse est très ancienne en réalité. Car n’oublions pas que Jung est un chercheur qui a redécouvert des idées présentes depuis toujours dans la psychologie humaine.
A) La mythologie grecque : un bazar organisé
Les dieux grecs : des personnifications de traits de la psychologie humaine
Chez les grecs, il n’y a pas un dieu unique, il y en a beaucoup. Quand on les prend tous ensemble, on se rend compte qu’ils se complètent, et qu’ils incarnent finalement tous les tendances humaines qui nous traversent : les valeurs, les désirs, les talents humains sont représentés, mais également les pulsions, et tous les traits humains plus sombres, de la juste colère à la folie meurtrière… Tout y est !
C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles en 2025, la mythologie grecque continue autant à fasciner et à influencer les arts. Parce que ce panel de divinités imparfaites, toutes capables de grandeur et de vice, de grâce et de vengeance, ressemble intimement à ces humains qu’il garde, protège et punit.
Des hommes pilotés par des dieux impulsifs
Les hommes, chez les grecs, sont soumis à l’influence de dieux tout aussi imparfaits qu’eux. De plus, ces dieux, lorsqu’ils se disputent sur le mont Olympe, de disputent aussi dans la tête des hommes. Les conflits des dieux d’en haut résonnent dans l’esprit des humains et s’expriment dans leurs divisions familiales et dans leurs guerres.
Pire encore : les dieux utilisent les hommes pour régler leurs comptes entre eux !
Ainsi en résumé, nous avons:
- Des dieux qui sont des personnifications de traits de caractère humains.
- Plus des hommes soumis à ces dieux qui font la pluie et le beau temps dans leur esprit et les commandent.
= Autrement dit, dans la culture grecque, les dieux olympiens pourraient représenter les complexes autonomes qui pilotent l’individu “d’en haut” c’est-à-dire depuis sa psychologie. Mais également “d’en bas”, avec les divinités chtoniennes, qui représenteraient les complexes autonomes plus archaïques, relatifs aux instincts.
C’est pourquoi, étudier la mythologie grecque est très intéressant lorsqu’on s’intéresse à la psychologie, et particulièrement pour prendre la mesure de ce concept de “complexe autonome”.
Achille, Ulysse, mais aussi Héraclès et Thésée… Oreste et Clytemnestre ! Tous sont tiraillés entre plusieurs valeurs, qui sont en fait personnifiées par différents dieux qui n’ont pas la même vision des choses.

B) Comment la mythologie grecque peut nous servir ?
Découvrir son paganisme personnel
Nous pouvons nous inspirer de ce paganisme antique pour visualiser ce qui nous tiraille. Par exemple, lorsque nous hésitons entre plusieurs façons de voir les choses, lorsque nous avons des difficultés à sentir ce qu’il est juste de faire et de penser… Lorsque nous avons du mal à ressentir une situation et d’y réagir de façon alignée, c’est qu’il y a en nous plusieurs tendances qui s’affrontent.
Ainsi pour démêler ce noeud, nous pouvons imaginer de les visualiser chacune, pour mieux les distinguer d’abord, et puis pour remonter au besoin personnel dont chacune de ces voix se fait le porte-parole.
Cela permet de passer le cap de “l’émotion”, de la réaction émotionnelle, et de gagner en discernement pour se rapprocher de ce qui est juste.
Exemple : une blessure d’injustice, Nemesis et Fantômette
Par exemple : l’autre réagit d’une manière qui ne me convient pas, je ne me sens pas respectée. Ca réactive des souvenirs plus anciens de situations similaires que je n’ai pas réussi à gérer comme j’aurais voulu. Ainsi il y aura un complexe autonome issu d’une blessure d’injustice qui va s’interposer.
Faire une pause et prendre le temps d’accueillir ce complexe autonome, c’est se mettre à l’écoute de ses besoins, et considérer que ce qu’il se passe aujourd’hui est une occasion de mieux réagir, et donc de consoler ce complexe autonome défiant.
Je peux ainsi le personnifier en l’appelant “ma blessure d’injustice” par exemple, mais également lui donner un qualificatif qui désamorce son importance “Fantômette en moi” ou encore prendre exemple sur la mythologie en l’appelant “ma Nemesis intérieure”. Nemesis étant la Fantômette des dieux grecques – en moins mignonne certes – déesse de la vengeance qui rétablit l’ordre.
Je vais maintenant vous parler de mes propres complexes autonomes pour vous donner une idée concrète de la chose.
V] Mes complexes autonomes (chéris et haïs)
Je vais vous présenter mes complexes autonomes principaux, ceux avec lesquels je dois cohabiter en bonne intelligence pour me sentir bien. En effet, l’idée n’est pas de corriger ces différentes facettes de notre personnalité, mais de les prendre en considération, de répondre à leurs besoins et de les rassurer pour qu’ils restent à leur place et limiter leur tyrannie. Dans un monde idéal, chaque facette de notre personnalité est à sa place mais, la vie étant mouvement, c’est un rééquilibrage constant, comme dans les douze travaux d’Hercule ou les péripéties d’Ulysse.
A) Je suis pluriel
L’intello
Je me suis identifiée à mon cerveau. J’étais une bonne élève parce que j’avais des facilités dans le milieu scolaire, et ma façon de ressentir de la validation de la part de mon entourage et de mes parents passait par là. Pas parce qu’ils me mettaient la pression, mais parce que ramener un bon bulletin était le meilleur moyen pour ressentir leur amour. Je vérifiais leur affection en les rendant fiers de mes résultats et donc de mes capacités.
C’est devenu un complexe autonome dans le sens où, lorsque je ne lis pas assez ou lorsque je n’étudie pas assez, la culpabilité arrive. Et également lorsque je suis fatiguée, démotivée et que mon cerveau ne suit plus, je panique, comme si j’étais en train de perdre mon point fort et ma valeur.
Pour nourrir ce complexe autonome, je dois avoir une routine de lecture minimum, mais également écouter des podcasts sur des sujets variés ou la radio, parce que j’adore ça. Autrement dit, je dois avoir le temps de me cultiver sans pression. Lorsque je ressens une pression à apprendre ou lorsque je surinvestis ce trait de ma personnalité, ça n’est pas bon, et c’est alors le signe que je n’accueille pas assez les autres parts de moi.
Ce complexe de l’intello nourrit une forme d’orgueil et également un syndrôme de l’imposteur, les deux étant de part et d’autre du spectre de cette sous-personnalité.

La fitgirl
J’ai fait beaucoup de danse et je suis hyperactive. J’ai un TDAH comme on dit aujourd’hui. Ainsi si je n’ai pas suffisamment d’activité physique, je vais compenser par une suractivité intellectuelle – en gros je vais surinvestir mon complexe de l’intello.
Aussi je dois faire une place dans mon planning au sport. Aujourd’hui je fais du fitness, je marche dès que je peux et j’aime bien nager aussi. Lorsque je vais trop loin dans le sport, et que je commence à chercher à observer une transformation physique, c’est le signal d’un excès. C’est pourquoi je parle alors des caprices de “la fitgirl en moi”.
J’ai fait de l’anorexie et c’est un des dangers de cette énergie en moi qui, en devenant désir de puissance, peut me faire tomber dans l’excès. A l’inverse, si je ne fais pas d’activité physique, je peux tomber dans une forme de déprime, car cette “fitgirl” en moi me permet d’alimenter mon stock de dopamine nécessaire à mon discernement et à tous les autres accomplissements.
Le ravi de la crèche
Je suis d’une nature plutôt joyeuse, j’ai la chance d’avoir une grande capacité d’émerveillement et c’est ce côté de ma personnalité que j’ai appelé “le ravi de la crèche”. J’ai constaté que dans une situation de joie, face à un beau paysage, entourée de personnes qui me sont chères, je peux monter très haut dans le sentiment de bonheur.
Mais “le ravi de la crèche” c’est aussi ma naïveté qui peut me faire croire parfois que je vis dans le monde des bisounours et avoir des difficulté à percevoir les dangers, ou les mauvaises intentions des gens.
En effet, le relationnel n’étant pas mon domaine de prédilection, les relations peuvent me créer de l’anxiété car je manque d’outils pour les appréhender. “Le ravi de la crèche” en moi voudrait que tout le monde soit gentil, honnête, ou à minima franc, et si ça n’est pas le cas, il peut paradoxalement me pousser à l’isolement.
Pour nourrir cet archétype je dois prévoir dans mon emploi du temps des sorties, des week-ends à droite à gauche pour nourrir ce besoin d’émerveillement. Pour soigner sa naïveté, je dois travailler ma fonction sensation et m’en tenir aux faits.
Caliméro
Lorsque mon stock de dopamine est à sec et en période pré-menstruelle – ayant un SPM costaud et un TDAH – arrive Caliméro. Ce complexe autonome là trouve que tout est difficile : le réveil, l’entretien de la maison, l’administratif, répondre aux mails et surtout écouter mon répondeur. Tout est difficile!
Caliméro a le dos voûté et plein de nœuds dans les cervicales et les épaules. Il a envie de se rouler en boule dans un coin et d’attendre que la vie passe.
Ce complexe se réactive lorsque quelque chose se passe mal. Les ruptures dans la vie, qu’elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, le touchent particulièrement et lui donnent raison de penser que je ne suis bonne à rien.
Pour être à l’écoute de ce complexe autonome, je dois respecter mes limites et les poser avec bienveillance, pas seulement par respect pour autrui mais aussi par bienveillance envers lui. S’il souffre, parfois c’est aussi qu’il a raison. On a tous un poète torturé en Soi, hypersensible aux douleurs du monde et qui se sent inadapté. Parfois, il faut commencer par l’écouter et pleurer un bon coup, c’est souvent la meilleure façon de le consoler.
Quand ça va mieux, il recommence à voler et va se poser sur un arbre. Il devient un gardien qui veille à ce que je fasse des choix qui ne me coûtent pas trop, et ainsi il compense le complexe du “ravi de la crèche”.

Bree Van de Kampf
Comme la fitgirl, le complexe autonome “Bree Van de Kampf” prend en charge ma dépense d’énergie. C’est la fée du logis un peu psychorigide qui habite en moi. Quand elle s’y met, je peux partir dans l’idée de nettoyer simplement la cuisine, et je me retrouve à récurer l’intérieur des placards, le frigo, la hotte… Sans voir les heures passer.
C’est un complexe autonome très pratique car elle est ultra-efficace. Et ça me fait vraiment trop plaisir quand j’ai cette énergie là de faire des tâches ménagères qui, en temps normal, ne me font pas rêver…
Grâce à elle, mes placards sont régulièrement rangés et je fais pas mal de tri. Je n’accumule pas d’objets inutiles, ce qui me va bien car je suis rapidement oppressée par les objets. Je suis plutôt du genre minimaliste.
Néanmoins, quand je pars vraiment dans un gros ménage de printemps sans préméditation, j’ai conscience que c’est une façon de gérer mon angoisse. Je peux me retrouver épuisée à la fin et insatisfaite car je vois ce qu’il reste à faire dans les autres pièces, comme si c’était vraiment une priorité – alors que ça ne l’est pas.
Et à l’inverse, lorsque je n’ai pas le temps de faire de gros ménage parce que j’ai une semaine très chargée, si je me sens anxieuse face à ce constat, je sais qu’il y a un déplacement ici. C’est à dire que je suis angoissée pour autre chose et que, plutôt que d’affronter le vrai sujet qui m’angoisse, je vais angoisser pour mon ménage.
Paradoxalement, j’ai une grande tendance à la procrastination, qui est en fait l’autre facette de la même pièce, comme on va le voir maintenant.
La procrastination
Ah la procrastination… Un vrai sujet !
La procrastination, contrairement à ce qu’on croit, n’est pas un défaut d’énergie. C’est de l’énergie qui est bloquée.
Lorsque ce complexe autonome apparaît, c’est le signal qu’il me faut me poser pour organiser les tâches que j’ai à faire. Je me sens absolument dépassée par tout ce que je dois faire, même quand en réalité il n’y a pas de quoi s’en faire une montagne !
Surtout quand il n’y a pas de quoi s’en faire une montagne d’ailleurs… Alors pourquoi je procrastine dans ces cas là?
Bien souvent, c’est parce que, dans le lot de trucs que j’ai à faire, il y en a certains pour lesquels je doute d’y arriver. Or, mes autres complexes autonomes liés à la performance me poussent à me mettre la barre haut.
Par exemple, si je dois écrire un article de ce genre, je vais partir du principe que je n’y arriverai jamais – j’ai procrastiné deux mois avant d’écrire cet article. Au lieu donc de me faire tout simplement violence pour “m’y mettre” – nota bene : ça ne marche pas, et ça renforce encore plus le blocage – il faut donc que je travaille sur la peur derrière ce blocage.
Par exemple : j’ai peur de ne pas réussir à être claire, à faire un article suffisamment complet, j’ai peur de partir dans tous les sens, ou de juste paraphraser Jung.
Ok, comment faire pour me rassurer ? En commençant par imaginer le plan de l’article. En notant des points. En programmant une journée pour le faire, une journée sans autre rendez-vous, juste dédiée à l’écriture.
Le plus pénible c’est quand je procrastine pour faire une valise. Maintenant, j’anticipe en faisant systématiquement une liste des choses à prendre dans ma valise, ce qui m’évite de me retrouver à buguer mille ans devant ma valise ouverte.
Lorsque je n’arrive pas à prioriser, je demande à quelqu’un de mon entourage de m’aider à le faire. Ce complexe autonome là, quand il apparaît, est souvent le signe que je veux trop me débrouiller toute seule et qu’il serait pas mal de demander de l’aide.
Chat GPT
C’est le complexe autonome à l’œuvre tandis que j’écris cet article. Une fois la procrastination dépassée et mon ébauche de plan posée, plus rien ne m’arrête. Je l’ai appelé mon “Chat GPT intérieur”. Ce qui est assez fascinant c’est que je découvre les idées au fur et à mesure que j’écris. J’avais juste fait un plan minimum – les gros titres – et ça se remplit spontanément, un mot succédant un un autre, dévoilant mes idées.
Ce Chat GPT intérieur semble bien branché à ce qui est dans ma tête. Mais parfois, rien ne vient malgré tout, et c’est alors le signe qu’il y a un branchement qui manque, et souvent, celui qui manque c’est celui qui se branche sur la prise de la joie d’écrire.
Car un bon moyen d’accueillir ces complexes autonomes, c’est de considérer que tous participent à notre épanouissement, même ceux qu’on aime moins, et que tous sont là pour nous aider à développer notre personnalité unique, dans toute la richesse de la diversité des tendances qui nous constituent, et de trouver de la joie à se découvrir soi-même.
J’en ai évidemment identifié pas mal d’autres, mais je pense que vous avez compris l’idée.

B) Renoncer au mythe de la cohérence absolue
Vous l’aurez compris, se connaître soi-même, c’est d’abord renoncer au mythe de la cohérence absolue. En effet, je peux être tout et son contraire, je peux être une fée du logis hyperactive, mais également rester bloquée plusieurs heures incapable de ne rien faire. Je peux être la plus joyeuse et également la plus asociale. Je peux me sentir incapable et également orgueilleuse.
S’accepter soi-même c’est accepter de n’être pas figé, d’être parfois d’une manière et parfois d’une autre, en réaction aux événements et à notre météo intérieure. Car plus on accueille et on reconnaît avec bienveillance nos différentes facettes, plus on gagne en estime de Soi. Cacher ou refouler une part de Soi c’est prendre le risque qu’elle se rebelle et qu’elle nous crée de vrais soucis. On revient sur l’idée de “j’ai pas pu m’en empêcher” ou “c’était plus fort que moi”, “je ne sais pas ce qui m’a pris”.
Au contraire, aller à la rencontre des différentes par de Soi, c’est aussi se découvrir riche d’une multi-potentialité, et donc au plus proche de notre nature profonde qui, à l’image de la nature qui nous entoure, est parfois douce et lumineuse, et parfois orageuse. Mais même les orages finissent pas passer.
VI] Rencontrer ses complexes autonomes en psychanalyse jungienne
Le concept de complexe autonome est un terme de psychologie analytique, la branche de la psychanalyse développée par Carl Gustav Jung pour se distinguer de la branche strictement freudienne. Néanmoins aujourd’hui, les guerres de chapelle entre jungiens et freudiens étant un siècle derrière, tout thérapeute peut trouver un intérêt à voir la psyché sous ce prisme là.
A) L’individu, l’individuation et ses complexes autonomes
Un individu unique et multifacette
Pour résumer ce qui a été dit plus haut, nous considérons que la personnalité d’un individu n’est pas un bloc cohérent, répondant à une logique et à une rationalité parfaite. Mais qu’un individu est une âme qui s’exprime de plusieurs façons parfois assez différentes, voire apparemment contradictoires.
Ce que nous nommons “complexes autonomes” sont donc ces différentes facettes de Soi qui ne sont pas toujours visibles au premier abord, et qui constituent comme des sous-personnalités du Moi.
L’individuation : être riche de tout ce que l’on est
L’individuation est l’objectif de la personne qui cherche à devenir elle-même, c’est-à -dire à se rapprocher au plus près de son authenticité et de sa nature profonde. Pour cela il va falloir qu’elle apprenne à respecter ses besoins, à tenir compte de ses zones d’Ombre, à reconnaître ses torts et ses mérites aussi. Il va falloir qu’elle découvre ses potentiels endormis, qu’elle soit ouverte à changer son regard sur elle-même pour s’accueillir dans sa complexité. Au passage elle découvrira que sa complexité ne fait pas d’elle quelqu’un d’incohérent, mais quelqu’un de riche.
Ainsi le travail en psychanalyse jungienne va accompagner ce parcours de connaissance et de reconnaissance de soi.
B) Quand on a un invité en séance
La psychanalyse n’est pas une thérapie brève. C’est plutôt un travail de fond. Ainsi on a le temps de laisser monter ce que l’inconscient amène en séance, et c’est pourquoi c’est une forme de psychothérapie qui me convient. Parce que je suis lente, sûrement, et parce que je suis si fascinée par l’intelligence de l’inconscient que je lui fais confiance.
Lorsque le moment est venu de parler de certains sujets, l’inconscient va amener ça dans l’échange. Ca se fera tout seul, et puisque ça viendra à la confidence, c’est donc que ça sera exactement le bon moment pour en parler.
Ainsi au fil des séances je vais découvrir les complexes autonomes de mes analysants. Ils peuvent s’annoncer de façon plus ou moins affichée.
Le complexe autonome qui avance masqué
Le complexe autonome qui avance masqué ne veut pas qu’on le remarque. Il se fait passer pour le Moi. Néanmoins, on peut l’observer dans des affirmations trop tranchées, dans une certaine manière de défendre des valeurs, dans une assurance, réelle ou feinte, ou encore dans une vérité tenue pour vraie par la personne depuis Mathusalem et jamais remise en cause. Imaginez comme une étoile dans le ciel, on ne sait pas qu’elle est morte car on la voit encore briller.
Le complexe autonome qui force le passage
Là, on n’est pas sur une étoile. Imaginez une météorite! Une situation vécue récente ou l’évocation d’un souvenir va créer une boule d’émotion. On va la voir, la sentir, mais pour autant on aura du mal à se l’expliquer. Il y a là un complexe autonome qui débarque en créant un certain tumulte, et sûrement que ébranler la quiétude de la personne est sa seule façon de se manifester. Peut-être parce que cette météorite vient de loin, qu’elle avait été bannie loin du Moi pour de bonnes raisons à l’époque, et qu’elle déboule donc d’un autre espace-temps.
Le complexe autonome qui sort sa carte de visite
Parfois, on a même des complexes autonomes qui arrivent poliment, en montrant leur carte de visite. En général, c’est que ça fait un moment que la personne est en analyse, et donc qu’elle a compris comment ça marche. Elle-même a appris à reconnaître ces diverses tendances en elle et va chercher à les nommer. Comme j’ai fait moi-même dans plus haut dans cet article.
La projection
Parfois aussi le complexe autonome doit passer par la projection pour être reconnu. Le transfert étant une condition de la réussite du travail thérapeutique, et particulièrement en psychanalyse, une personne peut temporairement projeter sur l’analyste un contenu inconscient qui la concerne elle. C’est transitoire et c’est bien souvent nécessaire pour regarder ce contenu inconscient jusque-là introjecté.
C’est pourquoi avancer avec un thérapeute est plus efficace qu’avancer seul. L’autre n’est pas qu’une oreille, il est aussi un support de projection sur lequel vont pouvoir être transférés des parts de soi sous forme tout d’abord de nœuds d’émotion, pour ensuite les reconnaître comme étant à soi et pouvoir les démêler.
B) Les complexes autonomes dans les rêves
Le travail du rêve est évidemment idéal pour aller à la rencontre des différentes parties de soi ! Je trouve ça tellement fascinant que c’est pour cette raison que j’ai créé ce site internet, ainsi que la chaîne Youtube dédiée au travail du rêve, et que j’ai décidé d’écrire ma formation Le Labo du Rêve. En effet, être en mesure de proposer de travailler sur les rêves à ses patients, que l’on soit psy, thérapeute ou même coach, permet d’aller directement entendre les requêtes de l’inconscient de la personne, et donc de mieux observer ses problématiques.
Dans les rêves, on va donc bel et bien rencontrer ses complexes autonomes. Si ça vous intéresse de vous initier à l’analyse des rêves, voici le lien d’un cours gratuit : https://www.presentation.interpretationreves.fr/gratuit

VII] Petit exercice maison
Pour clôturer cette série de vidéos au sujet des complexes autonomes, voici un petit exercice que j’ai imaginé moi-même et que je peux être amenée à proposer à mes analysants, quand le besoin s’en fait sentir.
A) Une carte mentale… mentale (en fin d’article, vous savez que je commence à faire des blagues lourdes)
L’idée c’est de pouvoir se faire une carte mentale (…mentale héhé) des complexes autonomes principaux qu’on aura l’habitude de côtoyer. On va tous les poser sur papier, et voir si on les prend tous en compte ou s’il y en a qu’on néglige.
B) Comment ça marche ?
Par exemple, j’ai proposé cet exercice à une analysante. Elle a listé sur une feuille de papier les parts d’elles qu’on avait déjà rencontrées au cours de nos séances, ainsi que dans ses rêves.
Ensuite je lui ai demandé de faire comme une carte mentale. De les noter à nouveau en les disposant chacune dans une bulle représentant un ballon, en cercle, et de se dessiner elle au milieu.
On s’est arrêtées sur chacune de ses sous-personnalités, en nous demandant à chaque fois : est-ce que je lui donne un espace pour s’exprimer dans ma vie ? De quelle façon? Est-ce qu’elle me cause du souci ou est-ce qu’elle a pris ses fonctions normales dans mon système? Est-ce que je dois envisager des améliorations ou est-ce qu’elle est exactement à la bonne place?
On a continué comme ça pour chacune de ses sous-personnalités. Lorsque le complexe autonome ainsi désigné était à sa juste place, elle reliait son personnage (au centre du cercle) à la bulle correspondante. Comme si elle – son personnage sur le dessin – tenait des ballons.
Arriva un complexe autonome qu’elle a admis ne pas du tout respecter. Il s’agissait de son rapport à son corps, de faire circuler son énergie au niveau corporel. Cette analysante a une grande propension à la créativité et elle avait à ce moment-là tendance à faire passer son inspiration avant tous ses besoins, même les plus fondamentaux (manger, dormir, marcher…).
Alors, force a été de constater qu’il y avait ici un déséquilibre dangereux. Elle savait alors exactement avec quel aspect d’elle-même elle devait renouer pour être à l’équilibre : le corps, l’incarnation, l’activité physique. Une surcharge de libido (au sens jungien d’énergie vitale) dans le cerveau devait être dépensée aussi dans le mouvement, et dans la formidable créativité du corps, sans lequel il n’y a pas de réel accès à création, en tant que recherche spirituelle.
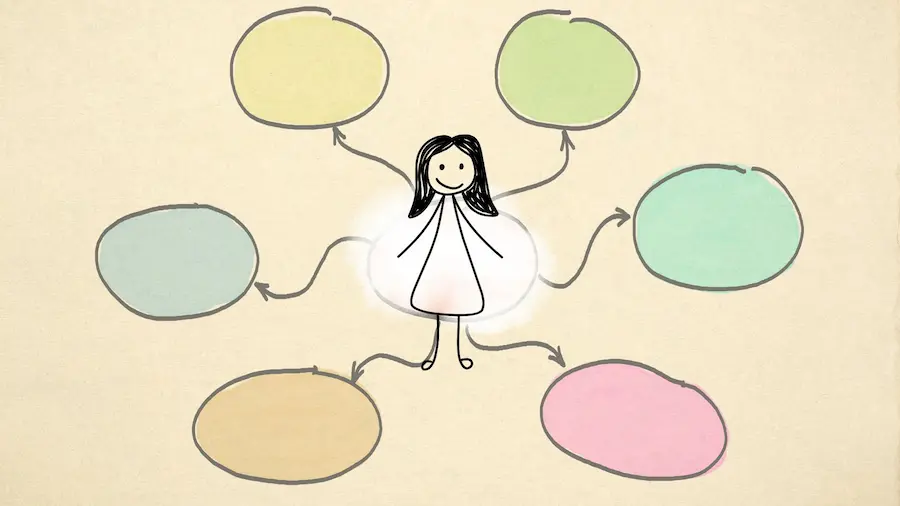
Conclusion sur les complexes autonomes :
Être tout ce que je suis, c’est tout simplement être entier. Ainsi, paradoxalement c’est en acceptant d’être pluriel que je me rapproche le mieux de mon authenticité. Parce qu’être pluriel, c’est aussi être adaptable, c’est donc être souple, et pouvoir mieux affronter les péripéties de la vie. Qui est rigide est facile à briser. Qui est souple, supporte mieux les chocs.
Avancer dans son individuation c’est donc passer par ce constat de notre pluralité intrinsèque pour faire alliance avec elle et devenir “un” et “indivisible”. Pour devenir l’individu qui embrasse toutes ses facettes et qui n’est plus divisé, tiraillé, ou dissocié.
Merci de m’avoir lu !
Faites de beaux rêves et notez les !
Léa Le Gall
Si cet article vous a plu, je vous invite à regarder mes vidéos sur Youtube à propos du rêve et de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung
Voir la chaîne YT de Léa Le Gall
Publié le
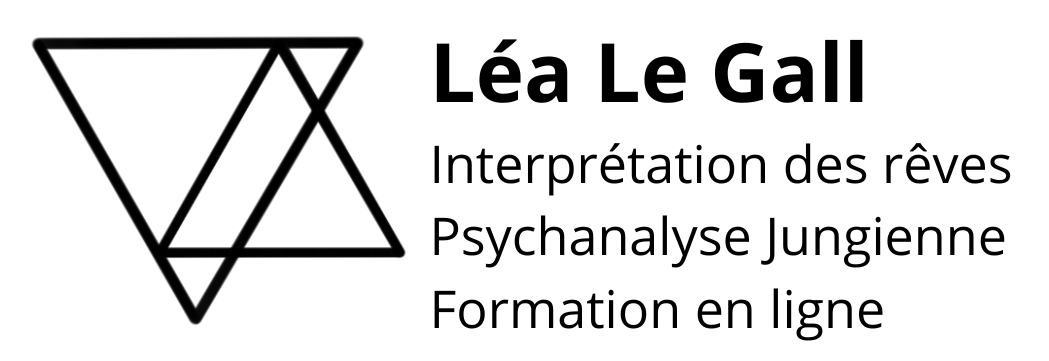


4 Commentaires:
Merci Lea pour cet article très intéressant
Très bonne idée la carte mentale je vais faire la mienne 👍
Super Pascale, j’espère que ça t’aidera ! 😉
Tout ça me semble très clair… et édifiant.
Bravo et merci, Léa, pour cet article fort intéressant !
Merci beaucoup Françoise 🙂